G.L. : Dans l'album F.52, il est question d'un avion qui va relier Paris à Melbourne en moins de 24 heures. Mais quel avion ! C'est un avion atomique ?
Y.C. : Oui, c'est ça, je me suis inspiré des Science et vie de la fin des années quarante. On y voyait des avions à l'image de mon F.52. On pensait que les avions du futur seraient géants, stratosphériques et atomiques. En 1949, le réacteur venait à peine d'émerger. Le Super-Constellation était encore à hélices.
- Outre Freddy Lombard, Sweep et Dina, parlons un peu des personnages qui sont dans cet avion.
- Les autres personnages sont surtout des psychopathes. L'histoire a l'ambition d'être une fable, un conte, dans un univers dramatique et clos.
- Il y a un espion, dont les chaussures jouent un grand rôle.
- L'espion russe, oui. C'est un clin d'oeil au grand classique des années cinquante qu'était l'espion russe.
- Il y a aussi une petite fille et sa mère.
- Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire en détail. Disons que l'avion est compartimenté. Il y a une classe de luxe et une classe économique. Dans cette dernière, se trouvent une mère et son enfant, lequel enfant passe en classe de luxe et alors le drame éclate. Ce n'est pas racontable... En réalité, il faut absolument acheter l'album.
- Ca c'est vrai ! Ce qui m'a amusé, c'est que le petite fille lit Spirou, un Spirou de l'époque. Vous avez été très loin dans la reconstitution du passé.
- Je suis féru de vieux magazines, j'ai des collections chez moi, et je n'ai pas pu résister au plaisir de les faire figurer.
 - C'est en 1981 que vous avez créé Freddy Lombard, ce héros à la houppette tintinesque.
- C'est en 1981 que vous avez créé Freddy Lombard, ce héros à la houppette tintinesque.
- Je l'ai créé sans trop y réfléchir. Je l'ai fait pour un petit éditeur, Magic-Strip, dans une collection de rééditions de classiques. Et comme il s'agissait d'un hommage aux vieux albums de la collection du Lombard, je l'ai appelé Freddy Lombard. Ce premier album s'appelle Le Testament de Godefroid de Bouillon, car l'action se déroulait à Bouillon, en Belgique, dans les Ardennes. J'y suis allé pour me documenter. Quand je suis revenu chez moi, j'étais tellement imprégné par l'atmosphère que je n'ai pas eu besoin d'écrire un scénario. J'ai dessiné directement. Je faisais une page par jour. A la trentième page, la fin est venue spontanément. Ce fut vraiment un travail d'écriture automatique.
- D'après ce que vous venez de dire, cette première histoire de Freddy Lombard est venue facilement. Mais qu'en a-t-il été des autres ?
- Pour la deuxième, il s'agissait d'une histoire exotique qui se passait en Afrique. J'ai toujours eu un faible pour la mythologie coloniale. Je l'avais faite pour un journal hollandais, Eppo, qui était très vivant à l'époque et l'est beaucoup moins aujourd'hui. Bien que destinée aux enfants, au départ, l'histoire a été publiée, en France, par les Humanoïdes Associés, plutôt spécialisés dans la bande dessinée pour adultes. Mais les adultes ont adoré.
- Donc, Le Cimetière des éléphants constitue le second épisode. Et le troisième, la Comète de Carthage ?
- Le troisième a été écrit avec Yann Lepennetier. On a utilisé la même technique que pour le premier. On s'est rendu à Cassis pour s'imprégner, hors saison touristique, avec vent, pluie, etc. Puis on est rentré à Paris afin d'écrire le scénario. Mais cela n'a pas été aussi facile. Comme quoi il ne faut pas essayer de faire deux fois la même chose. Cela a même été très difficile, avec des mois de travail. On avait, en plus, une épée de Damoclès au-dessus de la tête : la prépublication mensuelle dans Métal hurlant. On n'avait pas de temps pour trouver une fin. Alors, pour l'album, j'ai fait des remaniements, j'ai modifié un peu l'histoire pour donner une cohérence à l'ensemble.
- Et pour le quatrième épisode, en 1988, intitulé Vacances à Budapest ?
- Là, on est parti de l'insurrection hongroise de Budapest en 1956, événement qui a énormément marqué les consciences occidentales de l'époque. Dans les bandes dessinées, cela a été totalement occulté. On s'est dit, il y a des albums, dans les années cinquante, qui n'ont pas été écrits. On n'est pas allé à Budapest, on a lu énormément de livres, on a essayé de faire revivre cette époque.
 - Nous voici en 1989-1990 avec F.52, cinquième et dernier album de Freddy Lombard. Est-ce qu'un sixième est prévu ?
- Nous voici en 1989-1990 avec F.52, cinquième et dernier album de Freddy Lombard. Est-ce qu'un sixième est prévu ?
- Non, pas pour l'instant. Je fais des petites choses à gauche et à droite. Mon activité se partage entre l'illustration et la publicité. Cela me prend beaucoup de temps. En bandes dessinées, je ne veux pas adopter la carrière de mes illustres aînés qui, eux, se cantonnaient à un personnage et le faisaient vivre dix ou vingt ans. Moi, je suis très versatile. J'aimerais changer de personnages et, éventuellement, faire évoluer mon style, varier mes préoccupations scénaristiques.
- J'aimerais revenir dans le passé. Comment a commencé cette envie de dessiner ?
- Je suis de ces gens qui ont été nourris, dès leur enfance, à la bande dessinée. A la campagne, j'avais des cousins chez lesquels se trouvaient quantité d'albums en mauvais état et des numéros de Spirou dépareillés. Dans mon premier album, Captivant, j'ai essayé de retrouver cette ambiance, d'évoquer des morceaux d'histoires en deux ou trois pages, sans même commencer ou terminer un épisode.
- Déjà, à l'époque, vous vouliez faire de la BD ?
-Non, c'est venu tout naturellement : il y avait le goût du dessin. Puis j'ai fait l'école des Beaux-Arts de Saint-Etienne où j'ai rencontré Cornillon, qui était fanatique de bandes dessinées américaines. On a sympatisé, on a réalisé un fanzine et, ensuite, on a travaillé pour Métal Hurlant, en desinant ces petits morceaux d'histoires inachevées qui ont constitué l'album Captivant.
- J'aimerais qu'on revienne sur l'époque des fanzines. Vous avez créé deux fanzines. J'ai noté Biblipop lors de mes recherches... C'est ça ?
- Biblipop, oui, j'y ai fait des dessins ; mais le fanzine qu'on a créé aux Beaux-Arts, c'était L'Unité de valeur, en 1976.
- Et Athanor ?
- C'est un autre petit fanzine, toujours de l'époque des Beaux-Arts de Saint-Etienne. C'était un fanzine local, de Roanne, je crois. Il y avait beaucoup d'émulation. Serge Clerc y a travaillé. Cela nous a permis de recueillir beaucoup d'informations, d'avoir un regard critique sur la bande dessinée.
- Dans vos histoires, il y a des clins d'oeil aux dessinateurs des années cinquante et soixante : Jijé, Tillieux, Hergé bien sûr... mais il me semble que vous avez été influencé aussi par des auteurs américains ?
- Oui, c'est un peu grâce à Cornillon, qui est un grand amateur de comics. J'admire Alex Raymond, Milton Caniff, les classiques des années quarante. Curieusement, aux Etats-Unis, les oeuvres de la nouvelle génération de dessinateurs : Dave Stevens, Bernie Wrightson, Jeff Jones, même mâtinées d'underground, s'inspirent aussi des grands classiques américains d'avant-guerre.
- Il y avait Kirby aussi...
- Oui, avec son trait puissant ; mais lui faisait partie de l'ancienne école. C'est un peu, aux Etats-Unis, l'équivalent de Jacobs ou de Franquin.
- Vos premiers travaux, en tant que professionnel, ont été pour Métal Hurlant. Comment s'est passé votre entrée à Métal ?
- Très facilement, car le marché, à l'époque, était porteur, comme on dit. Il y avait de nouvelles revues qui avaient besoin de dessinateurs. Le début, pour moi, ça a été la presse et pas l'album. De courtes histoires, faites rapidement. Et d'ailleurs, mon premier album, Captivant, était très hybride. Ce n'était pas un album standard, avec un début et une fin ; plutôt un concept, une ambiance...
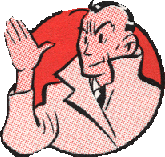 - Puis il y a eu Bob Fish ?
- Puis il y a eu Bob Fish ?
- Oui, je pensais à Jean Valhardi, à Jijé, à toute cette époque années cinquante. Ca se passait à Bruxelles, où je n'avais jamais mis les pieds. J'ai imaginé un détective avec des pantalons larges, des grands imperméables... On est très prisonnier de son époque. Les mouvements, on ne les invente pas, on les subit. J'ai l'impression d'être un bouchon sur une rivière tourmentée.
- Ce qui est amusant dans Bob Fish, c'est qu'il y avait une chauve-souris géante au-dessus de Bruxelles. Vous êtes-vous inspiré, pour cette chauve-souris, d'une bande américaine ?
- Pas du tout, je me suis inspiré d'une bande de Bob et Bobette. Pas de Batman.
- Non, je pensais à une bande publiée dans le magazine Pulps, où il y avait une chauve-souris géante qui s'appelait Zoura. Je me demandais si vous n'aviez pas subi cette influence.
- Non, ce serait peut-être même l'inverse. Mais il est vrai que mon objectif était de « pomper », pomper à tout prix ! La BD se voulait créatrice, les lecteurs reconnaissaient un auteur par son style, par son héros, etc. Moi, j'ai déclaré d'abord : « je n'ai pas de style ! ». Dans Captivant, il y avait autant de styles qu'il y avait d'histoires. Je dessinais noir et blanc, clair-obscur, au pinceau, à la plume, je mélangeais les techniques. Quand on me demandait : « quel est ton style ? », je trouvais la question absolument saugrenue. Je ne voulais pas faire une carrière standard (et, d'ailleurs, je ne veux toujours pas la faire) avec un style, un personnage... Je pense qu'il faut éviter d'avoir de la personnalité : c'est la chose la plus redoutable qui puisse être. Pour moi, le pompage, copier, imiter, appartenaient à la même démarche : prendre tout ce qui me semblait intéressant, à toutes les époques d'ailleurs.
- Bob Fish, donc, et aussi le jeune Albert.
 - Oui, c'était un petit personnage secondaire, un gosse qui, dans mon esprit, était le véritable héros de l'histoire. Bob Fish était le héros classique et standard. Albert devait servir de repoussoir. Le héros devait sortir de la foule, contrairement à la plupart des histoires où on campe le héros dès la première page : noble, loyal, généreux, pouvant sauver la veuve et l'orphelin. Pour moi, les héros, on ne doit pas les voir du premier coup. Par exemple, De Gaulle, pendant le Première Guerre mondiale, qui aurait pu deviner qu'il deviendrait un héros de la Seconde Guerre mondiale, puis de la Ve République ? Au début, Albert aurait été très anecdotique, puis je l'aurais fait monter tout doucement. Grâce à sa cruauté, sa lâcheté, il serait parvenu au statut de héros.
- Oui, c'était un petit personnage secondaire, un gosse qui, dans mon esprit, était le véritable héros de l'histoire. Bob Fish était le héros classique et standard. Albert devait servir de repoussoir. Le héros devait sortir de la foule, contrairement à la plupart des histoires où on campe le héros dès la première page : noble, loyal, généreux, pouvant sauver la veuve et l'orphelin. Pour moi, les héros, on ne doit pas les voir du premier coup. Par exemple, De Gaulle, pendant le Première Guerre mondiale, qui aurait pu deviner qu'il deviendrait un héros de la Seconde Guerre mondiale, puis de la Ve République ? Au début, Albert aurait été très anecdotique, puis je l'aurais fait monter tout doucement. Grâce à sa cruauté, sa lâcheté, il serait parvenu au statut de héros.
- Autre personnage : un chef d'entreprise, Adolphus Claar.
- Vous savez, à l'époque, j'avais coutume de dire que tous les matins, en me brossant les dents, j'inventais un nouveau personnage. Adolphus Claar n'a pour moi aucune importance. Je ne veux pas en parler comme ça parce que c'est l'ensemble de la démarche qui m'intéresse.
- Mais vous avez très bien parlé jusqu'ici de cette démarche... Est-ce que vous avez rencontré vos idoles : Jijé, Tillieux, Hergé, etc. ?
- Non, non, je n'en ai pas eu l'occasion. Je ne connais que Franquin, rencontré à plusieurs reprises, et Giraud.
- Mais ceux qui vous ont inspiré, vous ne les avez jamais rencontrés ? Ils ne vous ont jamais écrit, contacté ? Ils connaissaient votre oeuvre, quand même ?
- Je ne sais même pas. Et, très honnêtement, je n'ai jamais cherché à les rencontrer. Je pense qu'il y a une incommunicabilité à la base. D'ailleurs Franquin, lui, se moque de mes dessins. Il ne peut pas comprendre qu'un jeune dessinateur des années quatre-vingts puisse s'inspirer de ses anciens dessins.
- Mais il ne renie pas ses dessins des années cinquante ?
- Un petit peu. C'est ce que je trouve dommage.
- Quand on parle de Franquin, on pense à Spirou. Vous me voyez venir avec mes gros sabots : on va parler du Spirou que vous avez réalisé. Comment cela s'est-il passé ?
- C'était une époque où les Editions Dupuis cherchaient des dessinateurs pour prendre la relève de Fournier. J'ai fait une petite histoire improvisée qui paraissait chaque semaine dans Spirou, sur un scénario assez insipide.
- Pourquoi votre collaboration au journal, avec le personnage de Spirou, s'est-elle arrêtée ?
- Il y a eu plusieurs raisons. la première, parce que je demandais trop d'argent, la seconde c'est parce que j'ai laissé traîner l'histoire trop longtemps.
- Il y a eu du courrier de lecteurs ?
- Pas à ma connaissance.
Quelles sont vos passions quand vous ne dessinez pas ?
- Je lis pas mal, je vais au cinéma. J'ai toujours l'impression que je travaille, à vrai dire...
(Transcription de Michel Denni)
* Le Collectionneur de Bandes Dessinées,
3, rue Castex,
75004 PARIS.